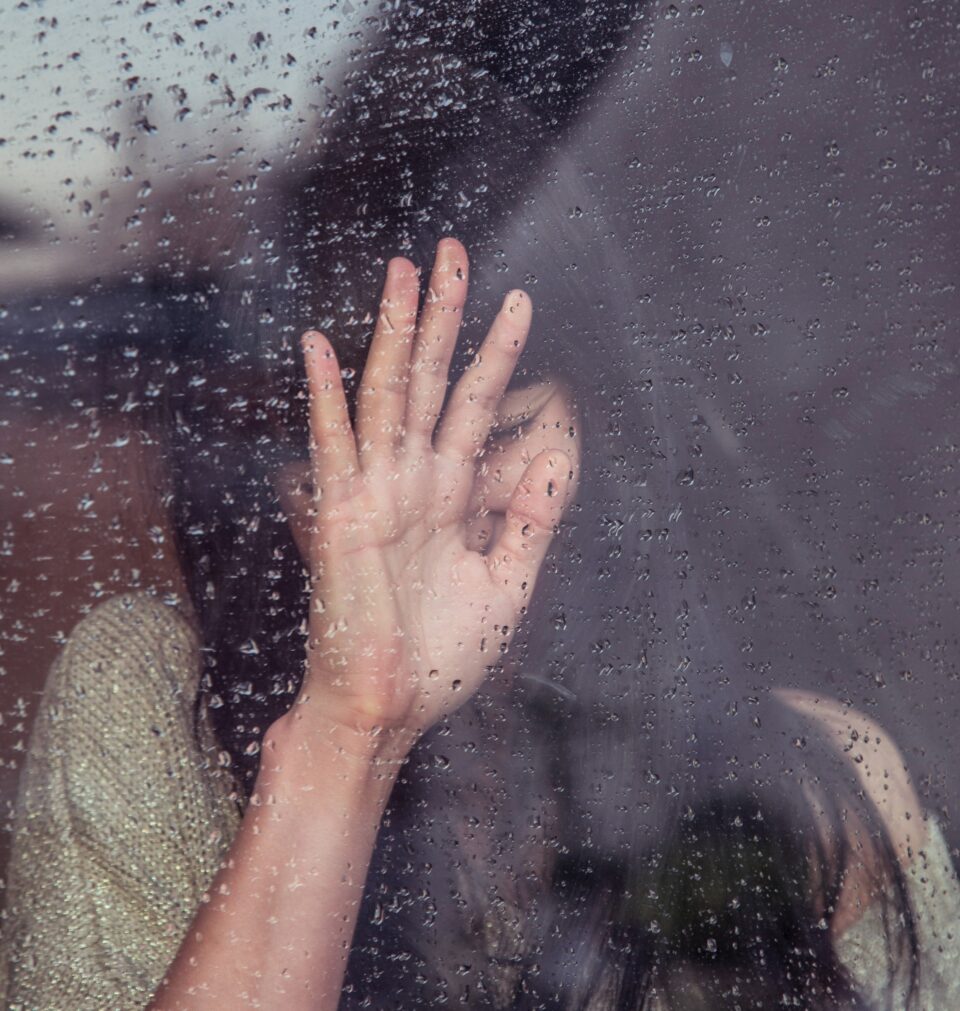Miroir, miroir, dis-moi qui je suis ?
En France, ces derniers mois sont remplis de discours d’oppositions brutales. Es-tu de gauche ou de droite ? Es-tu de souche ou es-tu immigré ? Es-tu pro-palestinien ou pro-israélien ? Manges-tu bio ou trouves-tu que les fruits et légumes sont trop chers ? Comme si ce qui nous définit était d’un côté ou de l’autre. Pourtant, chaque individu est une palette d’identités.

Dans l’interculturel, on parle rarement d’une seule identité culturelle. On parle cependant des identités en lien avec différents contextes (genre, sexe, famille, religion…) et activités menées (éducation, métier, loisir…). On était élève, on devient des professionnels, on était des amis, on devient des ennemis. La vie nous amène en avant à travers plusieurs identités qui nous permettent de nous retrouver dans un espace présent. Mais les identités ne sont pas statiques. Elles sont nourries par les expériences de vie, elles évoluent, elles changent tout au long de la vie. Cela veut aussi dire qu’il y a de nouvelles identités que nous obtiendrons et celles que nous perdrons.
La perte d’une identité peut bien être volontaire. La décision de changer de métier ou de reprendre les études mène inévitablement à un changement de posture. Après des années de travail en tant qu’employé, l’expérience des entrepreneurs montre que quoi qu’ils fassent, ils doivent essayer une nouvelle approche. Notamment ceux qui quittent leur CDI pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Dans mon entourage, une collègue a laissé son carnet d’adresse au milieu d’entreprises pour commencer une activité artisanale. Au début, elle était apprentie, puis elle est devenue la personne en réseautage, analyste du marché et de la concurrence, la prestataire de service ou créatrice de produits naturels. Elle a appris à faire face à l’échec, à l’absence de client, à l’incompréhension des proches. Dans ces cas-là, nous pouvons percevoir ces changements identitaires sans que cela ne nous apporte de confusion.
De la poche trouée, son identité est tombée
Ce processus n’est pas identique pour les immigrés. Leurs rôles sociaux sont redéfinis. On était frère, sœur, fille, et soudainement, on devient chef de famille, un adulte. On était reconnu par notre communauté, respecté, mais on devient restreint par la langue et la patience des autres ; on devient des inconnus. Ces identités n’ont pas évolué, mais ont été forcées à l’abandon. De nouvelles identités se sont imposées : étranger, voleur d’emploi, solitaire.
L’identité culturelle des personnes d’origine étrangère n’appartient plus à son porteur. Il est exigé que les personnes se conforment à des normes de la société d’accueil. De plus, avec la mondialisation, une crainte de perdre les racines culturelles s’agrandit. Les tribunes ont été payées pour montrer le danger de l’homogénéisation culturelle, où les cultures locales perdent leur spécificité au profit d’une culture mondiale uniforme. Ainsi, tout l’étranger doit disparaître. On entend « préserver son identité », mais on n’entend jamais « élargir son identité ». Comme si les influences extérieures pouvaient nuire à l’intégrité de soi. Donc, une personne en immigration aurait moins de considération pour sa bonne intégration si elle préserve quelques rites de sa première culture. Pourtant, c’est bien ça la bonne intégration interculturelle, où plusieurs cultures se fusionnent et s’enrichissent. À la table de Noël, le foie gras se marie avec la salade russe.
Certes, la diversité est plus difficile à apprivoiser. Ce n’est pas une chose qu’on peut laisser par terre et arracher les mauvaises herbes. La diversité doit être enseignée. Le partage n’est pas naturel et contredit nos réflexes de survie. Mais comme nous sommes des êtres sociaux et que les bienfaits du brassage culturel ont fait leurs preuves, on peut trouver des solutions.
Qui suis-je ?
Je suis le reflet de ce que les gens disent de moi, de ce que ma famille pense, de ce que les professeurs m’ont appris et de ce que je cache.
Les identités se forment surtout par la perception d’autrui et les attentes des autres envers soi. Elles se sculptent par des interactions. Ainsi, on peut parfois cacher certaines identités, comme l’éducation, les opinions politiques et bien d’autres identités non visibles. Ce qui n’est pas toujours possible à dissimuler, ce sont les identités visibles, telles que l’ethnicité ou le genre, qui peuvent être rapprochées.
Dans mon cas, les Français n’oublient pas de me souligner
« Ah, vous avez un accent ! ».
Les Russes me jettent aussi à la figure
« Ah, vous avez déjà un accent ! ».
Le prix à payer pour avoir moins d’accent dans une langue étrangère est de développer un accent dans sa langue maternelle, phénomène appelé attrition.
Ainsi, ce sont les autres qui définissent mon identité : pas encore française, mais déjà pas russe non plus. Moi, je ressens comment une Sibérienne se mélange à une Parisienne. Je ne suis certainement pas frileuse quand l’hiver nous rappelle qu’il existe, mais plutôt râleuse quand il bloque le service de transport.
Un accent qui disparaît au fil des années ferait moins de dégâts que les rites et pratiques qui ont été forcés à l’abandon. « Quand j’étais petite, je ne devais dire à personne que je venais d’une famille pratiquante », me raconte une amie. Un effort pour une meilleure intégration qui laisse une trace de culpabilité, voire de honte parfois… Et parfois, comme toute chose imposée, avec le temps, cela crée un rejet de cette autre identité tant souhaitée. De même, avec des préjugés, de la discrimination et de l’inégalité, certaines identités doivent être dépoussiérées.
On ne voit rien dans ce vieux miroir
Quand on ignore certaines de nos identités, quand on ne les sollicite pas, il est facile de vouloir répondre aux attentes des autres en devenant un être lisse, sans histoire. Mais lorsque l’on travaille sur soi, lorsque l’on réfléchit à la richesse que l’on porte en nous, à la vitalité qui peut grandir, on assume plus facilement ce que nous sommes. Ainsi, nous pouvons faire face.
L’identité n’est jamais une substance univoque.
Nous n’avons pas besoin qu’un miroir nous dise qui nous sommes, mais nous avons besoin de lui pour nous voir, réfléchir, redéfinir nos nouvelles identités et accepter ces changements.